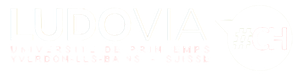POUR SOUMETTRE UNE COMMUNICATION :
Déposez votre proposition sur EasyChair :
APPEL À CONTRIBUTIONS
LUDOVIA 2026

mutAtIons: quand le numérique transforme les métiers et la formation tout au long de la vie
Le numérique a pris une place centrale dans notre société aujourd’hui et il est devenu indispensable d’en maitriser le fonctionnement (les usages) mais aussi d’en saisir les enjeux sociaux et sociétaux qui en découlent. Ce rôle prépondérant du numérique, et en particulier de l’Intelligence Artificielle (IA), amène à de profondes mutAtIons dans les métiers mais aussi en formation.
Dans ce contexte, 2 axes prioritaires sont concernés par cet appel à contributions dans le cadre du colloque scientifique LudoviaCH#26 qui aura lieu à Yverdon-les-Bains du 20 au 22 avril 2026.
Le premier concerne les mutations liées à la place du numérique dans les différents corps de métiers,que cela soit dans leur nature (enseignant·e·s et formateur·trice·s, ingénieur·e·s, économistes, développeur·euse·s, etc.) et le deuxième s’intéresse à la posture des professionnels face à leur métier en mutation et par rapport à leur formation tout au long de la vie.
AXE 1 : Une mutation (ou révolution ?) accélérée et inédite des métiers
À l’ère des intelligences artificielles génératives (iag), et de leur démocratisation depuis plusieurs années dans toutes les sphères de la société, il est aujourd’hui possible de se questionner par rapport à la nature même des métiers et à leur définition.
Par exemple, alors que les iag permettent de disposer en quelques prompts d’un code à appliquer pour faire de la programmation, on est en droit de se questionner sur l’importance pour un·e ingénieur·e de poursuivre l’apprentissage du code informatique.
Cela peut amener vers d’autres questionnements, proches des apprentissages fondamentaux. Par exemple, doit-on (ou peut-on) aujourd’hui se passer de certains gestes qui ont fait notre histoire ? Doit-on toujours savoir écrire ? Et quels nouveaux gestes doit-on créer ? Aussi, les chirurgiens ont-ils aujourd’hui toujours besoin des mêmes compétences et connaissances pour effectuer des opérations assistées par le numérique ? Ou dans un domaine proche, les radiologues doivent-ils encore savoir détecter à l’oeil nu un cancer ou une maladie alors que l’ia peut le faire pour eux plus rapidement (Achour, Zapata, Saleh et al. 2025) ?
Ceci n’est pas sans conséquences sur la formation car ce contexte amène parfois les étudiant·e·s à se questionner par rapport à leur futur rôle dans ces métiers et les détourne de certains parcours de formation (Hassankhani et al., 2024). Ceci s’applique à la médecine, mais aussi au journalisme (Sonni et al. 2024), à l’enseignement (Many et al. , 2024, 2), à l’agriculture, à la restauration, etc.
Dans cet axe, pourront être traitées, entre autres, les questions suivantes :
- Comment l’ia, ou simplement le numérique, modifie certains métiers ?
- Quelles sont les mutations professionnelles les plus importantes, surprenantes, indispensables, voire regrettables ?
- Où se situe la maîtrise nécessaire dans les savoir-faire aujourd’hui ?
- Existe-t-il des savoirs-faire ou des savoirs-être que le numérique ne saurait remplacer, accompagner, bonifier ?
- Peut-on aujourd’hui parler de déshumanisation de certains corps de métiers ?
Dans ce monde professionnel en constante mutation, la formation initiale ne suffit plus à garantir la pérennité des compétences. C’est l’objet de notre second axe.
AXE 2: “S’engager durablement dans un processus de formations en constante transformation”
L’obsolescence rapide des savoirs et des outils impose aux professionnels de tous secteurs une adaptation continue. Le numérique, par son rythme effréné d’innovation, bouleverse les métiers, modifie les pratiques et exige un changement de posture vis-à-vis de l’apprentissage.
La formation continue devient alors une nécessité stratégique autant qu’un impératif éthique. Elle s’intègre dans le concept plus large de formation tout au long de la vie ou lifelong learning (Collins, 1998 ; Duke, 2001 ; Elfert, 2018) qui englobe toutes les formes d’apprentissages (formels, informels, personnels ou professionnels). Ce processus n’est plus linéaire ni cloisonné : il s’adapte aux transitions professionnelles, aux mobilités, aux changements organisationnels et technologiques.
Ainsi, se former ne relève pas d’une démarche ponctuelle, mais d’un engagement durable. C’est accepter que le métier évolue, que les compétences se transforment, et que l’expertise ne se construit pas une fois pour toutes, mais se cultive dans le temps. Ce changement de posture nécessite aussi une évolution des dispositifs de formation : plus souples, plus contextualisés, plus proches des situations de travail…
Dans cet axe, pourront être traitées, entre autres, les questions suivantes :
- Qu’est-ce que la formation à l’ère du numérique ? Comment former les étudiant·e·s ?
- Comment évoluent les contenus, les modalités, les processus d’évaluation et de certification ?
- Quel est le rapport des étudiant·e·s, enseignant·e·s et professionnel·le·s à la formation tout au long de la vie ? Quel changement de posture cela implique-t-il ?
- Comment se positionnent les employeur·euse·s et instituts de formation dans ce contexte particulier ?
Dans le cadre de cette édition du colloque scientifique LudoviaCH 2026, il est également possible d’en soumettre concernant différents domaines en lien avec le numérique et l’éducation/formation :
– Enseignement de l’informatique
– Intégration du numérique en formation
– Numérique et différenciation pédagogique
– Littératie numérique
– Éducation aux médias et à l’information
– Réseaux Sociaux
– Prévention et formation aux risques liés au numérique
– Datafication et learning analytics
– Apprentissage par le jeu
…
Les propositions de contribution prendront la forme d’un synopsis de 4 pages maximum (page de titre et bibliographie y compris) respectant le modèle téléchargeable ici
Le synopsis sera anonymisé (les noms et références des auteurs seront remplacés par une suite de xxxx).
Les propositions de contribution seront évaluées en double aveugle par un comité scientifique international au regard de leur pertinence par rapport à la thématique du colloque, leur caractère original, leur lisibilité et leur rigueur scientifique d’un point de vue théorique, méthodologique et argumentatif.
Les soumissions retenues feront l’objet d’une communication orale de 30 mn (20 mn de présentation + 10 mn de questions).
Elles seront publiées, à l’issue du colloque, sous forme d’actes disponibles au téléchargement. Les communications qui ne respecteront pas le format exigé seront rejetées.